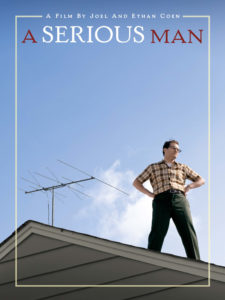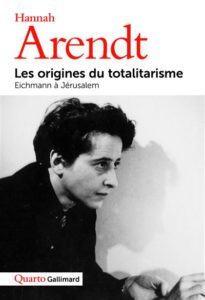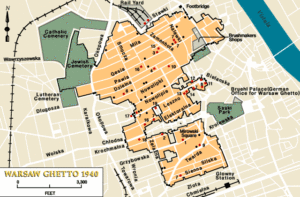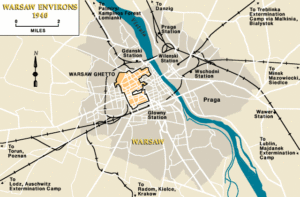En Israël, les élections législatives de mars 2021 ont enfin permis de clore la période Netanyahou, inculpé depuis 2019 pour corruption, fraude et abus de confiance. Un nouveau gouvernement de coalition très large a été investi le 13 juin.
Il s’appuie sur les élus à la Knesset (parlement israélien) des partis suivants : Yamina (parti de Naftali Bennett, très à droite, réunissant laïcs et religieux), Nouvel Espoir (fondé par Gideon Saar, ancien du Likoud ; situé plutôt à la droite du Likoud), Israël Beytenou (parti laïc et nationaliste fondé par Avigdor Liberman, également ancien du Likoud), Yesh Atid (parti centriste et laïc de Yaïr Lapid), le parti Bleu-Blanc (coalition centriste présidée par Benny Gantz), le parti travailliste (parti qui a longtemps dirigé le gouvernement israélien mais très déclinant, actuellement sous la présidence de Merav Michaeli), le Meretz (parti laïc et socialiste, à gauche du parti travailliste, présidé par Nitzan Horowitz), Ra’am liste arabe unie (parti arabe, présidé par Mansour Abbas).
: Yamina (parti de Naftali Bennett, très à droite, réunissant laïcs et religieux), Nouvel Espoir (fondé par Gideon Saar, ancien du Likoud ; situé plutôt à la droite du Likoud), Israël Beytenou (parti laïc et nationaliste fondé par Avigdor Liberman, également ancien du Likoud), Yesh Atid (parti centriste et laïc de Yaïr Lapid), le parti Bleu-Blanc (coalition centriste présidée par Benny Gantz), le parti travailliste (parti qui a longtemps dirigé le gouvernement israélien mais très déclinant, actuellement sous la présidence de Merav Michaeli), le Meretz (parti laïc et socialiste, à gauche du parti travailliste, présidé par Nitzan Horowitz), Ra’am liste arabe unie (parti arabe, présidé par Mansour Abbas).
La coalition représente 61 députés sur 120, donc a une très faible majorité. Naftali Bennett est premier ministre pour deux ans et sera ensuite remplacé par Yair Lapid.
Pour faire un premier bilan, les organisations JCall et La Paix Maintenant ont reçu le 8 novembre (1) :
– Gaby Lasky, avocate spécialiste des droits de l’homme, députée du Meretz, membre des commissions des Lois : « Statut des femmes et Egalité des genres » et « Affaires étrangères et Défense ».
– Denis Charbit, historien politologue, Open University of Israël, auteur de nombreux ouvrages sur le sionisme et la société israélienne (2).
Gaby Lasky prend la parole la première :
Elle considère ce gouvernement de très large coalition comme un miracle après les années Netanyahou. Si le Meretz a décidé d’y participer malgré ses différences essentielles avec les autres partis, c’est parce qu’il pensait que ce gouvernement pouvait sauver la démocratie et qu’il serait possible de travailler sur des sujets communs.
GL considère qu’il y a eu d’ores et déjà des avancées : un nouveau budget a enfin été voté début novembre alors que le budget précédent n’avait pu qu’être reconduit depuis 2018. Nisan Horowitz, ministre de la Santé et membre du Meretz, a obtenu 2 milliards de shekels (0,58 milliards d’euros) pour le budget de la santé ; une réforme de la cacherout diminue le rôle du rabbinat dans les prises de décision. Il y a un nouveau statut pour l’environnement qui aligne Israël avec d’autres pays. Des mesures d’égalité entre hommes et femmes, religieux et non religieux, juifs et arabes ont été actés. Par exemple la réalisation de trois nouvelles villes dans le Neguev pour les bédouins. Pour Gaby Lasky c’est un gouvernement de changement. Continuer la lecture →